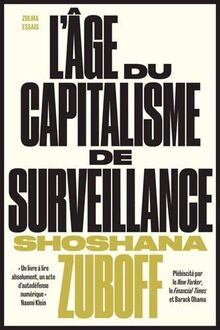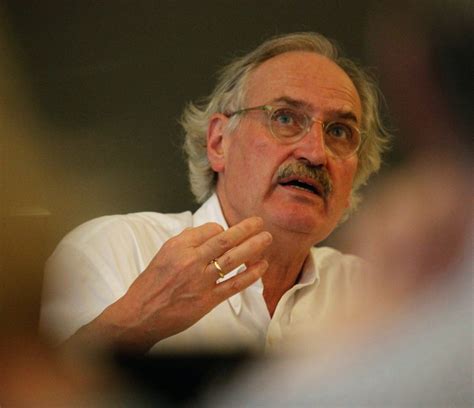Le mois dernier, le Centre Européen des Travailleurs (EZA) m’a sollicité pour intervenir dans un débat sur le rôle des politiques progressistes dans la lutte contre le populisme. Il m’a semblé utile d’adapter cette intervention pour en permettre la lecture.
Un concept polysémique
Le concept de populisme est polysémique. Tantôt, il est utilisé pour stigmatiser un adversaire, d’autre fois pour qualifier des régimes illibéraux comme celui d’Orban ou pour définir des formations d’extrême droite comme le Rassemblement national en France ou le parti post-fasciste de Georgea Meloni en Italie. Certains, comme Mélenchon en France ou la philosophe belge Chantal Mouffe plaident même pour un populisme de gauche. Pierre Rosanvallon, qui a consacré un livre sur le populisme[i] parle d’un concept caoutchouc ou d’un mot-écran.
Pour ma part, sans avoir la prétention de définir le concept, je me contenterai ici de me référer aux courants politiques de droite radicale dont nous pouvons repérer quelques traits caractéristiques ;
- La notion d’un « peuple-un » qui s’oppose à la prise en compte de la pluralité inhérente à toute démocratie. Une caractéristique déterminante des régimes totalitaires est la négation des divisions du corps social.
- La référence à un pouvoir vertical refusant les formes d’intermédiations sociales dont les organisations syndicales ou les mutualités font partie. Les gouvernements élus n’ont pas à s’encombrer de discussions ou de négociations avec la société civile. Leur élection leur donne un pouvoir plein et entier.
- Le non-respect de l’État de droit qui prévient l’usage arbitraire du pouvoir par les autorités. C’est pour cette raison qu’il est important de garantir la liberté de la presse ou l’indépendance du système judiciaire.
- La recherche et la stigmatisation de boucs émissaires dont les étrangers, le racisme.
- L’antiféminisme et l’homophobie.
- Le mépris des élites qu’elles soient politiques, économiques, institutionnelles ou même sociales
- Un repli sur une vision nostalgique de la nation et un refus de l’idée européenne
- Une vision d’une famille sur le modèle du patriarcat autoritaire[ii]
- Pour certains, une attitude plus qu’ambiguë vis-à-vis du régime de Poutine.
Ces mouvements construisent leurs discours avec des causalités simples, simplifiant à l’extrême les réalités. Par contre, les progressistes se doivent d’intégrer les réalités systémiques qui exigent de leur part de faire preuve de pédagogie afin de rendre la complexité naturelle des choses accessibles pour le plus grand nombre.
Dans l’Union européenne, la lutte contre les idées de l’extrême droite passe, notamment, par quelques actions concrètes ;
Que faire ?
- Dire et expliquer ce que l’Union européenne fait
Le désamour d’une partie importante de la population vis-à-vis de la politique et des institutions n’est pas propre à l’Union européenne, il est mondial et porte sur l’ensemble des niveaux de pouvoir. En ce qui concerne l’Union européenne il est conforté par le manque de proximité et la méconnaissance du fonctionnement de l’Union européenne et des politiques qui sont mises en œuvre.
Bruxelles c’est loin, et les députés sont peu visibles. Passant l’essentiel de leur vie à Strasbourg ou à Bruxelles ils ont peu de contacts directs avec leurs électeurs. Il leur faut redoubler d’énergie pour profiter de tous les moments, de tous les temps pour rester en contact avec les citoyens. La proximité et le contact humain sont des éléments déterminants et il faut être attentifs au fait que le temps de la démocratie ne peut se limiter aux périodes électorales.
Quant aux médias, il faut constater qu’ils accordent généralement trop peu de place aux questions européennes. C’est une responsabilité partagée entre professionnel des médias et politiques.
En permanence, nous devons démontrer et expliquer la plus-value de l’Union européenne de façon concrète. Mettre en avant des outils comme l’Erasmus, qui ne concerne qu’une partie limitée de la population n’est pas suffisant, il faut aller au concret, à ce qui touche les citoyens dans leur vie quotidienne. Si nous avons pu répondre au défi posé par la pandémie c’est grâce à l’UE qui a pu organiser les commandes et la distribution des vaccins. Dans les entreprises, avec les équipes syndicales il nous faut montrer les avancées concrètes en matière de non-discrimination, de santé et de sécurité ou de dialogue social. À titre d’exemple, montrer que les directives protégeant les salariés des substances cancérigènes permettent de sauver des dizaines de milliers de vies par an. C’est au quotidien qu’il faut démontrer la plus-value de l’UE.
- Dire qui fait quoi
La défense du projet européen passe également par une attitude plus courageuse de nombreux politiques. Trop souvent, nos politiques nationaux, par facilité, expliquent aux citoyens que ce qui ne va pas bien est de la faute des politiques européennes et pensent ainsi se protéger de toutes critiques leur action sur le plan national. Ce n’est pas comme cela que l’on réconciliera les citoyens avec l’idée européenne. Au moment du referendum sur le Brexit, Cameron s’est étonné de la difficulté de contrer les « bruiter » oubliant que pendant des années il avait continuellement expliqué que l’Union était la source de tous les maux britanniques.
Trop souvent, certains politiques ou certains médias dénoncent les politiques de l’UE alors que celles-ci ne possèdent pas de compétence sur les matières concernées ou que celles-ci dépendent uniquement des États nationaux. Je pense par exemple à la sécurité sociale, à une grande partie des politiques migratoires ou à la fiscalité. Les politiques, ainsi que les médias doivent faire preuve de plus de pédagogie pour permettre aux citoyens de savoir qui décide quoi, les États, le Conseil, la Commission ou le Parlement. Au passage, il est important de renforcer les compétences du Parlement.
- La cohérence des politiques
Une des réponses que nous devons apporter est de poursuivre le développement d’une Europe sociale. C’est ce qui a été mis en place par feu Jacques Delors et poursuivi, après la parenthèse désastreuse de Barroso, par Jean-Claude Juncker puis Madame Von der Leyen. Certes, tout cela doit être approfondi et les chantiers sont immenses.
Il en va de même pour la dimension écologique où les politiques doivent répondre aux attentes de transitions justes. Au passage, je ne suis pas convaincu que la remise en cause du volet vert de la PAC, soit, à terme, une réponse pertinente face à la crise agricole. S’aligner sur les exigences de l’agro-industrie ne va pas renforcer la situation d’une agriculture familiale de qualité.
La cohérence elle est surtout à chercher dans le lien à faire entre les politiques sociales et environnementales et la politique budgétaire. Comment être crédible quand d’une part on parle de renforcement des politiques sociales et en même temps imposer des règles budgétaires qui conduisent à l’austérité ? À titre d’exemple, l’accord sur la gouvernance économique va contraindre un pays comme la Belgique à faire des économies supplémentaires de presque un pour cent du PIB (0,65).
La cible des économies promises est déjà connue, elle est dans les programmes des formations de droites, limitation des allocations de chômage, mise en cause du rôle et des moyens des mutualités de santé, attaque contre le syndicalisme et cerise sur le gâteau diminution des moyens de la sécurité sociale au travers de politiques de déduction fiscale.
- Lutter contre la désertification des territoires
Les politiques inspirées par l’ultralibéralisme conduisent à un abandon de certains territoires comme les quartiers périphériques, les banlieues et les régions rurales. Dans nos villages, de moins en moins d’administrations, les banques disparaissent les unes après les autres, les services médicaux sont de moins en moins accessibles…. Cela produit le développement d’un sentiment d’abandon qui, inévitablement, renforce les discours des droites extrêmes.
- Répondre aux attentes sociales
Lutter contre la montée des populismes c’est certainement apporter une réponse aux attentes sociales de la population. Ces réponses, nous pouvons les trouver dans le manifeste de la Confédération européenne des Syndicats ou dans le programme du groupe des travailleurs du Comité Economique et social Européen. Il s’agit certainement des questions d’emploi et de revenus, de l’amélioration des conditions de travail, de la lutte contre la précarité (singulièrement dans les plates-formes), du renforcement du dialogue social, d’une meilleure prise en compte des enjeux de santé et de sécurité et d’une transition juste pour répondre aux défis climatique et environnemental.
Un référentiel européen en crise
Je pense que l’on ne peut comprendre la montée des populismes et des courants opposés à l’approfondissement de la construction européenne qu’en prenant en compte la crise des mouvements politiques qui ont été les bâtisseurs de l’UE. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les sociaux-démocrates et les sociaux-chrétiens qui ont permis l’avancée de l’idée de la nécessité de la construction européenne. Aujourd’hui, ces deux courants politiques qui ont eu un rôle structurant pendant des dizaines d’années sont en crise. D’un côté, la social-démocratie s’est égarée entre une tendance se contentant d’accompagner le néo-libéralisme en en limitant les effets négatifs pour les salariés et une autre tendance se réfugiant dans un verbiage gauchisant. De l’autre côté, la démocratie chrétienne s’est de plus en plus présentée comme fer de lance du néo-libéralisme et d’un conservatisme éthique. Le concept d’économie sociale de marché semblent se résumer à l’adoption d’un fondamentalisme du marché reléguant au second plan les ambitions sociales.
Reconstruire de nouveaux récits positifs
J’ai la conviction que face à la progression des courants que nous dénonçons nous devons reconstruire des récits positifs. Nous pouvons notamment le faire en nous appuyant sur celles et ceux qui nous ont précédés. On nous parle souvent de l’importance de l’axe franco-allemand. Je voudrais à mon tour le faire, mais à partir des idées qui, me semble-t-il, peuvent permettre de reconstruire des récits porteurs d’avenir. La démocratie chrétienne européenne a pu s’appuyer sur des penseurs comme Emmanuel Mounier ou Marc Sangnier qui ont pensé le progrès social et l’Europe. Je pourrai rappeler deux paroles fortes, l’une de Sangnier qui disait que « demander à un homme de voter et puis l’écraser sous le poids trop lourd des inégalités économiques c’est se moquer de lui », et l’autre de Mounier qui affirmait la compète subversion de l’économie capitaliste « où la personne est soumise à la production qui est à son tour soumise au service du profit spéculatif ». Pour lui, « une économie personnaliste règle au contraire le profit sur le service rendu dans la production, la production sur la consommation et la consommation sur une éthique des besoins humains replacée dans la perspective totale de la personne [iii]».
Du côté de l’Allemagne, il me semble que nous pouvons nous appuyer sur des penseurs comme Habermas ou Axel Honneth qui a beaucoup travaillé sur la reconnaissance et la lutte contre le mépris.
Construire un pont entre une pensée prenant ses sources en France avec Mounier, Sangnier Ricoeur, mais aussi des intellectuels comme Claude Lefort ou Pierre Rosanvallon et une autre qui se réfère à l’École sociologique de Francfort avec Habermas, Honneth ou Hartmut Rosa qui, dernièrement, a publié « Pourquoi la démocratie a besoin de religion ».
S’il est un enjeu qui devrait être au cours de nos récits, c’est la santé des êtres humains et celle de la planète.
Ne pas vendre son âme au diable.
Je terminerai en évoquant un enjeu crucial lié aux prochaines élections européennes. Lutter contre le populisme, lutter contre l’extrême droite c’est contrer sa stratégie de dédiabolisation.
Ceci implique de refuser de reprendre ses thèmes, de refuser de cautionner par une présence politique dans les organes médiatiques qui charrient les idées d’extrême droite et enfin, c’est refuser, au parlement européen toute alliance avec ces formations.
En la matière, l’attitude que prendra le groupe conservateur (PPE) sera particulièrement importante. Ceux qui se réclament de l’histoire de la démocratie chrétienne perdraient toute crédibilité et tout sens de l’honneur en s’alliant avec les formations d’extrême droite. Il faut souligner les positions claires de l’association des travailleurs chrétiens CDA (aile ouvrière de la CDU) qui a clairement appelé à l’interdiction de l’AfD ou encore celle de l’UECDW qui lors de son dernier Congrès à Rome déclarait « Qu’en tant que démocrates-chrétiens, nous ne pouvons accepter aucune coopération avec les partis d’extrême droite, à quelque niveau que ce soit. Nous ne devons pas commettre l’erreur de coopérer avec les ennemis de la démocratie pour l’amour du pouvoir. Des limites claires sont nécessaires pour renforcer nos valeurs et notre démocratie.
[i] Pierre Rosanvallon, le siècle du populisme, Seuil – 2020
[ii] George Lakoff, La guerre des mots, Les petits matins – 2015
[iii] Emmanuel Mounier « Ecrits sur le personnalisme » Seuil 1961 – p146